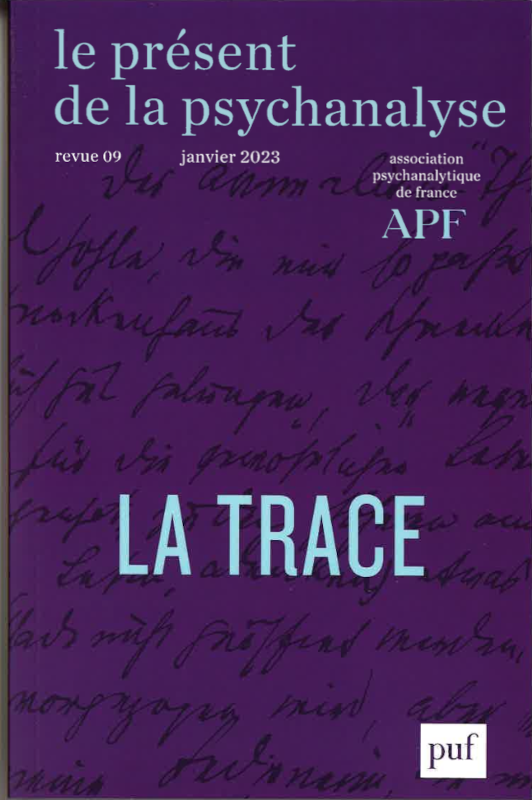Laurence Kahn – Précarité de la trace
Résumé – De l’enthousiasme soulevé par les grandes découvertes archéologiques de son siècle jusqu’à l’épreuve constituée par l’invasion de la barbarie, la trace mnésique demeure une pierre angulaire du bâti psychanalytique. Marquage invisible qui ne se fait connaître qu’à travers ses réactualisations au présent du transfert dans la cure ou par son pouvoir d’engendrer les répétitions meurtrières dans l’histoire, elle est régulièrement l’objet de virulentes critiques dans les procès en métaphysique de la psychanalyse, alors que dans le même temps la notion interroge sans répit le statut de l’événement matériel, la pertinence de la diachronie et la cohérence d’arrangements interprétatifs secondarisés.
Comment concevoir sans elle le retour du même sous l’aspect d’une forme absolument autre ? Comment se passer de l’économie de la décharge, elle-même directement articulée à la conception énergétique de l’empreinte mnésique de la satisfaction ? Comment travailler sans les preuves de sa matérialité sans pour autant succomber au relativisme ?
Mots-clés – Trace mnésique. Métaphore archéologique. Narration. Point de vue économique. Décharge. Réalisation hallucinatoire. Oubli. Répétition.
Jean-Michel Lévy– Impressions du souvenir
Résumé – Le souvenir est toujours altéré, déformé, remanié, toujours plus ou moins souvenir de couverture. Il est porteur de l’infantile au présent dissimulé dans un détail, une trace. Pour se remémorer pleinement dans la cure ce passé-présent, toutes les impressions du souvenir entrent en jeu, notamment celles qui restituent la dimension purement sensorielle de la trace.
Mots-clés – Souvenir. Régression. Trace. Figurabilité. Acte.
Michel Rey – Littéralement et dans tous les sens
Résumé – Dès qu’on prend en compte des séquences d’histoire, individuelle ou collective, on est confronté à des traces à rebours, destinées à produire le caractère homogène de ce qu’on présente. On voit ici tout l’intérêt de ce que Bergson a appelé « l’illusion rétroactive ». C’est un éclairage aux effets multiples dans la perspective d’un temps fabriqué pour des intérêts spécifiques.
Mots-clés – Fin de l’histoire. Rétroactivité. Fabrique de traces. Révisionnisme. Lissage de la civilisation. Prédictif
Françoise Laurent – Si toi aussi tu m’oublies
Résumé – Quelle trace chacun laisse-t-il dans la mémoire de l’autre ? À cette question Christian Boltanski a consacré son œuvre. Pour le psychanalyste, les traces mnésiques constituent à la fois le matériau de la vie psychique consciente, et l’outil de ses remaniements, auxquels procèdent le travail du deuil, et le travail de la cure. Celle-ci enrôle de plus la mémoire de l’analyste, qui tel un archéo- logue relève les traces laissées par l’inconscient de l’analysant dans la texture des séances pour ériger sa construction contre la puissance refoulante de l’oubli.
Mots-clés – Traces mnésiques. Image motrice. Substance. Construction. Deuil. Oubli.
Alexandre Morel – Prendre son masque pour son visage
Résumé – L’implicite est ce qui va sans dire. Comme le transfert. Ce dernier s’y entend pour défaire notre goût du sens. Quel jeu possible dans un système de contraintes identificatoires nous pousse à prendre corps et parole en séance ? En suivant les routes et les déroutes d’un moment de cure, dans la tension constante entre la mise en sens et le déploiement d’un certain nombre d’apparitions ou de personnages en séance, on pourra se demander : « Mais pour qui se prend-on ? »
Mots-clés – Implicite. Figuration. Incarnation. Personnages. Comme si. Transfert. Haine.
Philippe Quéméré – Indifferenz versus neutralité
Résumé – L’auteur se donne ici pour tâche de revisiter le mot indifferenz, que Strachey traduisit par neutralité, traduction qui aura des destins divers, parfois néfastes, sur la tech- nique psychanalytique. Après avoir, sur les pas de Freud, déployé la polysémie d’indifferenz et souligné l’écart avec indifférence et neutralité, l’auteur propose, filant la métaphore nautique, de la comparer au point fixe de l’étoile Polaire, assurant un cap idéal au navigateur analytique, lui évitant, bien qu’il soit inévitablement attiré par le chant des passions transférentielles, la dérive fatale vers les récifs du « simulacre d’humanité ».
Mots-clés – Indifferenz. Neutralité. Acte analytique. Singularité. Imprévu.
Bernard de La Gorce – Où tu vas comme ça ?
Résumé – La sauvagerie qui se déploie à travers le monde quand les barrières de la culture s’effondrent ou se pervertissent bouleverse les repères avec un retour de la frénésie collective vers l’intime ? C’est une bascule dans le non-sens marquant le passage d’un monde où le jeu pulsionnel était placé sous la gouverne d’un équilibre entre principe de plaisir et principe de réalité, à un autre monde où cette régulation se trouve mise en échec. Au-delà du principe de plaisir, témoigne de ce revers. « Nous sommes vécus par des forces inconnues, échappant à notre maîtrise. » Qu’est-ce que c’est que ça ? Et face à cela, devant ça, quand les digues sont rompues, la psychanalyse reste-t-elle en capacité d’ouvrir la voie à un espoir de transformation ?
Mots-clés – Ça. Destructivité. Déliaison. Principes de plaisir et de réalité. Imaginaire. Illusion. Transformation.
Jean-François Solal – S’incliner devant la jouissance ?
Résumé – En proposant la pulsion de mort couplée à la libido, Freud paraît souscrire à son habituel dualisme scientifique. Il constate toutefois que ces pulsions s’expriment de façon intriquée, comme dans la contrainte de répétition. Prenant appui sur le second exemple freudien, celui du masochisme, Lacan donne une place majeure à la jouissance. Sans jamais l’écrire, il tend ainsi à un monisme des pulsions : elles fusionnent quand vie et mort expriment la passion. Nous en donnons l’exemple chez Francis Bacon. La clinique contemporaine du trauma, notamment en temps de pandémie, et celle de l’addiction confirment la pertinence du concept de jouissance.
Mots-clés – Pulsion de mort. Dualisme. Monisme. Masochisme. Jouissance. Trauma. Addiction.
Brigitte Éoche-Duval – Le plaisir, une conquête sans cesse à venir
Résumé – Pour rester le gardien de notre vie psychique, le principe de plaisir doit se prêter à de multiples combinai- sons pulsionnelles imposées par l’antagonisme d’Éros et de la pulsion de mort. Quel est le traitement possible pour cette part non liée de la destructivité à l’œuvre dans le psychisme humain ? L’expérience transférentielle analytique, avec la ressource de créativité des processus primaires, permettrait qu’opèrent un alliage et une transformation pulsionnelle vers un gain de plaisir mobilisable dans la relation à l’autre.
Mots-clés – Plaisir. Éros et pulsion de mort. Déliaison et destructivité. Douleur. Expérience transférentielle analytique.